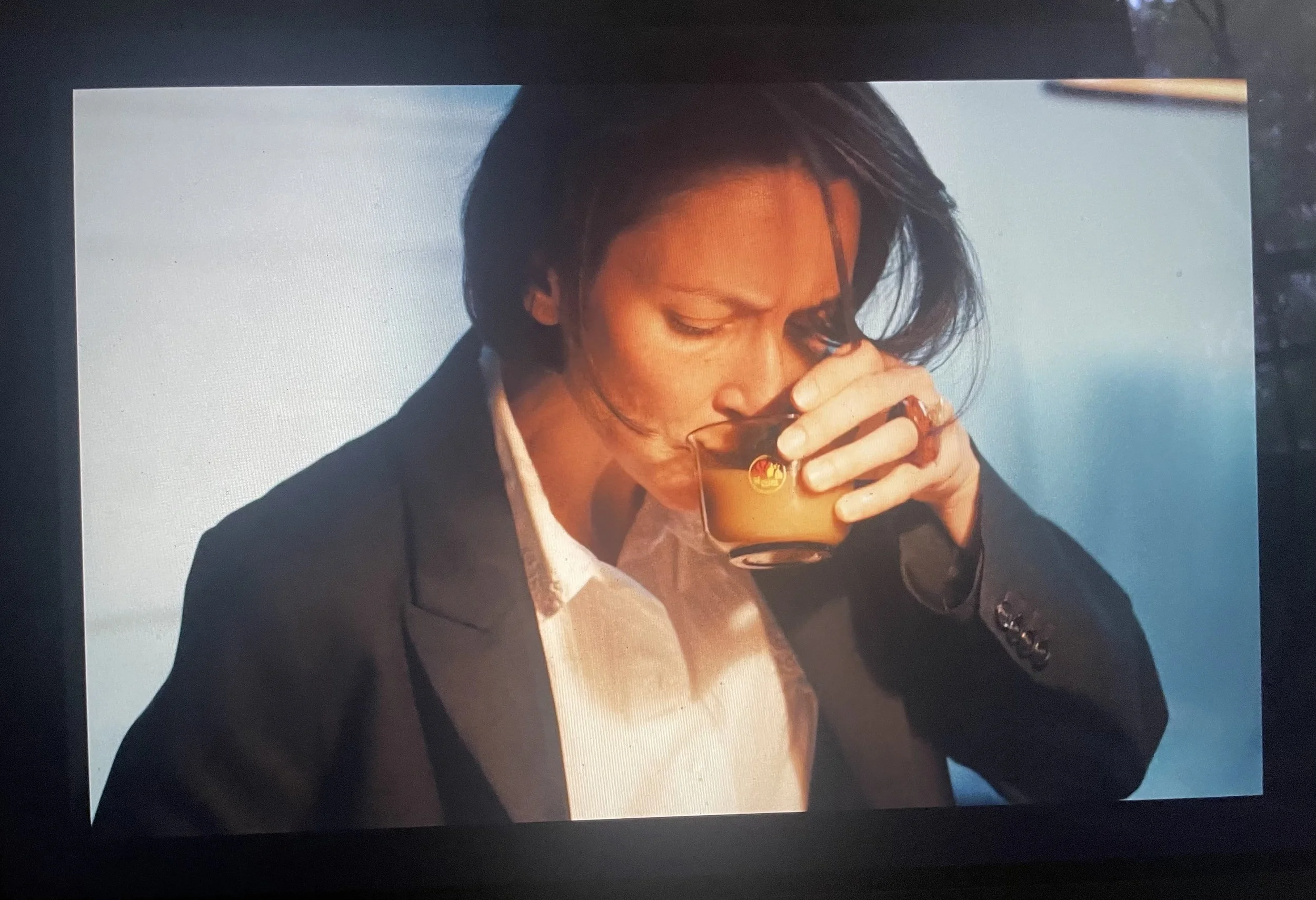le goût comme savoir sensible : savourer le design
Natalie Radmall-Quirke (eileen gray)
E.1027, Eileen Gray et la maison en bord de mer
Beatrice Minger Christoph Schaub 2024
Penser le goût par le design ? Une esthétique du goût peut permettre d’envisager des objets de design sous une forme gustative. En effet, il s’agit de voir comment des objets, non comestibles mais qui représentent des aliments comestibles, un agrume ou une citrouille, ou encore un avocat ou un fruit de baboab, peuvent nous permettre d’approcher ce qu’on appelle à la fois une anthropologie du “comportement esthétique et une philosophie du goût” (Simha, 2012) . Comment le goût a-t-il été délaissé par une partie de la philosophie ? Mais comment peut-il aussi se rapprocher du beau, par le fait même que ces objets ne soient pas comestibles, qu’ils soient considérés comme des objets d’art ? Il faut alors distinguer le beau de l’agréable.
i. le goût en philosophie et histoire de l’art : un sens qui manque de noblesse
Dans l’Antiquité grecque, le goût dans sa physiologie était dévalorisé, car “il soulignait une collusion du goût avec les fonctions digestives susceptible de nuire au mouvement de l’intellect’. (Assouly, 2019).
Le goût manque de noblesse par rapport aux autres sens. Or en philosophie, la recherche de vérité est ce qui prime, mais pendant l’époque des Lumières, il y a ceux qui considèrent les sens comme science, comme Montesquieu et Hume, et ceux qui font de la raison la principale source de l’objectivité, les rationalistes, comme plus ou moins Aristote et Kant qui questionne lui la raison.
Selon Kant, il y a un présupposé : l’essence de la sensation, particulière, compromet l’impératif d’universalité de la science. Le problème, c’est que « ni les sensations gustatives, ni les sentiments ne procèdent d’une quelconque détermination objective, or juger sur la beauté des choses implique un jugement objectif. Selon Kant, l’art se démarque « d’une vulgaire excitation organique par le sens concerné ». A la source de la satisfaction du spectateur devant une œuvre picturale, cest l’appréciation d’une forme qui prime sur la matérialité des couleurs.
Le beau présuppose une division entre plaisir vulgaire et plaisir pur. Dans une certaine mesure, selon les moralistes, ces objets en tant que représentations d’aliments comestibles ne peuvent constituer un plaisir :
« Conditionnée par la souffrance, la recherche du plaisir dépend moins de l’impact de la saveur en tant que telle, en soi plus ou moins agréable, que du soulagement induit par une ingestion » « C’est ainsi que des intempérants se donnent certaines soifs qu’ils entretiennent ; cercle vicieux consistant à se procurer du plaisir sans souffrir au départ d’aucun manque. » « (Aristote, Éthique à Nicomaque, op. cit., 1176 a1-4).
Aristote parle de « plaisirs gourmands » qu’il voit présent chez les humains et non chez les animaux. À l’abri de telles passions, « les animaux prennent plaisir non à l’odeur du lièvre, mais seulement à le manger. Tous les hommes abusant des plaisirs endossent à leurs dépens « une apparence servile et bestiale » (Aristote, Éthique à Nicomaque).
Le philosophe socialiste Charles Fourier, dans Le nouveau monde industriel et sociétaire (1829), critique les moralistes qui veulent limiter « le raffinement » aux beaux-arts, alors que selon lui, il « faudrait l’introduire en gastronomie, d’où il se répandrait partout ». Il faut promouvoir le goût culinaire, car la « morale a faussé la marche du bon goût », il faut généraliser la vertu de gourmandise et « élever le genre humain aux raffinements gastronomiques, même sur les mets les plus communs ». Alors que le goût a une teinte vulgaire car populaire.
Qu’importe, il veut étendre le raffinement dit ‘morale’ “sur la littérature et les arts… et veut associer « (une noblesse de sens au goût, même populaires ou) grossiers, qui (sont) sur la branche essentielle du système social, celle des subsistances… ».
Mais rentrer dans une exposition qui lie et lit design et goût, c’est rentrer dans l’esprit « physique » des sens, dans l’esprit physique du goût, comment celui ci nous affecte, à l’image des œuvres culinaires de l’exposition cookbook 19’ au MO.CO.
ii. mais le goût est une expérience empirique, subjective et valorisée par certain.e.s
Parmi les penseurs des Lumières, comme on l’a dit, il y a ceux qui considèrent les sens comme science, comme Montesquieu et Hume, et ceux qui font de la raison la principale source de l’objectivité, les rationalistes.
Dans l’histoire de la philosophie, on considère que Montesquieu opère « une conversion au subjectivisme ». Il s’agit grâce à lui de considérer le beau et le goût à l‘aune de l’expérience, on dit de façon “empirique”. Le goût devient un phénomène sensible et sensoriel, on mobilise les cinq sens. Le goût n’est plus, comme l’écrit le philosophe plus contemporain Cassirer, « coordonné, ni subordonné aux opérations logiques de la déduction et de la preuve, mais placé sur le même plan, dans son immédiateté, que les actes de la perception, voir et entendre, goûter et sentir ».
Le goût est finalement une science, une science du sensible. La science du goût de Brillat Savarin, est une science pratique, un savoir sensible : en gastronomie, “le savoir sensible, inhérent au goût, est (…) irréductible à toute formalisation (par la pensée)” (Simha, 2012). Le savoir sensible, c’est une expérience du goût - Savarin est l’inventeur de la gastronomie. Le savoir sensible, c’est aussi s’imaginer le goût.
Mais approcher une science du goût, c’est se laisser penser que le goût “n’est pas une chose mentale”, que c’est l’affaire de tous les sens, qu’il n’est pas seulement ni principalement “la mesure des plaisirs de l’âme” (Montesquieu, Essais, chap. 2).
Il faut dire aussi que les sensations gustatives renseignent sur nos affections. Le sentiment est relatif à l’identité matérielle des aliments, c’est-à-dire aux configurations atomiques dont ils se composent. Mais que nous indique la sensation in fine ? Que le plaisir est construction sociale, ou bien à chercher, et la douleur à fuir, et que nous cherchons peut-être par le goût privilégier le plaisir et fuir la douleur ?
Pour aller plus loin : les Lumières est un mouvement philosophique qui domina le monde des idées en Europe au XVIIIe (1715-1789).
Attention : simplification à dessein, par souci de synthèse, de la philosophie de Kant sur l’esthétique, jonchée d’une complexité de nuances.